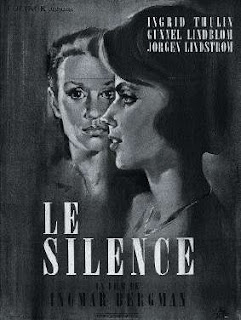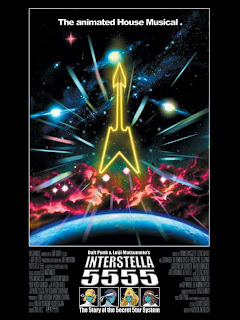Vous reprendrez bien un peu de ketchup avec vos macarons? L'histoire de Marie-Antoinette/Sofia Coppola est toute simple, elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment, en possession de moyens extraordinaires : ce n'est pas sa faute (sous-entendu qu'elle en ait usé de la sorte). Si je dois concéder une chose à Coppola-fille, c'est que le sujet de son film est limpide et en parfait accord avec lui-même, il constitue le summum du narcissisme artistique et de la frivolité avec ce zeste de mauvais conscience qui épice le tout, histoire de donner du grain à moudre à la critique : ce long métrage est très maladroit, filmé avec les pieds, creux mais un poil touchant (autant que peut l'être une petite fille qui s'amuse avec son jouet) et surtout cohérent, faut-il le descendre ou le louer? Le problème ne se poserait pas si l'on se souvenait que ça n'est pas la cohérence d'une oeuvre qui fait sa richesse, mais sa profondeur. Bref, passons. Ainsi donc elle n'y peut rien. Oui mais qu'elle éloigne son visage du miroir et elle verrait peut-être que personne ne l'y plaque, libre à elle d'agir à sa guise et de proposer véritablement quelque chose de consistant et d'artistique dans un long métrage digne de ce nom... Elle verrait que le mieux à faire était sans doute pour elle, et pour nous,... de ne rien faire, et surtout pas ce film. Décidément « Marie Antoinette » me plaît, car l'on y trouve tous les travers dans lesquels le septième art doit à mon sens se garder de plonger, s'il n'est pas déjà trop tard. Mais allons-y : tout d'abord et surtout, que de puérilité! Vous allez me dire que c'est le sujet. Et je vous répondrai, justement. Une puérilité savamment cultivée, une bêtise même que l'on rencontre partout : dans l'écriture des personnages, dans leur interprétation, dans les thèmes abordés (l'éternel passage à l'acte, l'oisiveté, les paradis artificiels, les excessives bonnes manières,...), mais aussi et en particulier dans la mise en scène du film. Notamment par cet amour du mauvais goût effrontément affiché, de l'anachronisme bien ostensible, rien de plus tendance d'ailleurs! Rien de mieux pour se figurer être une artiste, c'est s'assurer ainsi que les gens glousseront à la fin du film devant de telles bonnes idées! Les premières choses que l'on remarque sont en effet une composition du plan de temps à autres assez soignée et une photographie léchée, soit si l'on ajoute ce goût du pompier et du kitch les plus grossiers, l'équivalent cinématographique de l'« art » d'un certain David Lachapelle, soit un truc immonde assez drôle et ironique, que l'on pourrait prendre pour du « génie » avec un peu de naïveté et d'ignorance, mais qui relève surtout de la blague de potache, de l'enfantillage. Un pastiche divertissant en somme, pour peu que nos attentes frôlent l'herbe la plus rase... Et ça n'est pas fini, tant qu'on y est, puisqu'au cinéma il y a le son, autant faire passer ses chansons préférées du moment! Attends que je sorte mon ipod, hop, et voilà! Et puis autant faire poser, hum, jouer la famille et ses amis, plus on est de fous! Qu'est-ce donc que « Marie Antoinette » au final? Une petite bulle de savon (rose) prête à éclater, un joli cliché tendance, pour l'instant à la mode mais voué à se défraichir bien rapidement dans notre société de l'art consommable/jetable. Juste parce que l'on a tendu une caméra à Sofia Coppola.
Vous reprendrez bien un peu de ketchup avec vos macarons? L'histoire de Marie-Antoinette/Sofia Coppola est toute simple, elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment, en possession de moyens extraordinaires : ce n'est pas sa faute (sous-entendu qu'elle en ait usé de la sorte). Si je dois concéder une chose à Coppola-fille, c'est que le sujet de son film est limpide et en parfait accord avec lui-même, il constitue le summum du narcissisme artistique et de la frivolité avec ce zeste de mauvais conscience qui épice le tout, histoire de donner du grain à moudre à la critique : ce long métrage est très maladroit, filmé avec les pieds, creux mais un poil touchant (autant que peut l'être une petite fille qui s'amuse avec son jouet) et surtout cohérent, faut-il le descendre ou le louer? Le problème ne se poserait pas si l'on se souvenait que ça n'est pas la cohérence d'une oeuvre qui fait sa richesse, mais sa profondeur. Bref, passons. Ainsi donc elle n'y peut rien. Oui mais qu'elle éloigne son visage du miroir et elle verrait peut-être que personne ne l'y plaque, libre à elle d'agir à sa guise et de proposer véritablement quelque chose de consistant et d'artistique dans un long métrage digne de ce nom... Elle verrait que le mieux à faire était sans doute pour elle, et pour nous,... de ne rien faire, et surtout pas ce film. Décidément « Marie Antoinette » me plaît, car l'on y trouve tous les travers dans lesquels le septième art doit à mon sens se garder de plonger, s'il n'est pas déjà trop tard. Mais allons-y : tout d'abord et surtout, que de puérilité! Vous allez me dire que c'est le sujet. Et je vous répondrai, justement. Une puérilité savamment cultivée, une bêtise même que l'on rencontre partout : dans l'écriture des personnages, dans leur interprétation, dans les thèmes abordés (l'éternel passage à l'acte, l'oisiveté, les paradis artificiels, les excessives bonnes manières,...), mais aussi et en particulier dans la mise en scène du film. Notamment par cet amour du mauvais goût effrontément affiché, de l'anachronisme bien ostensible, rien de plus tendance d'ailleurs! Rien de mieux pour se figurer être une artiste, c'est s'assurer ainsi que les gens glousseront à la fin du film devant de telles bonnes idées! Les premières choses que l'on remarque sont en effet une composition du plan de temps à autres assez soignée et une photographie léchée, soit si l'on ajoute ce goût du pompier et du kitch les plus grossiers, l'équivalent cinématographique de l'« art » d'un certain David Lachapelle, soit un truc immonde assez drôle et ironique, que l'on pourrait prendre pour du « génie » avec un peu de naïveté et d'ignorance, mais qui relève surtout de la blague de potache, de l'enfantillage. Un pastiche divertissant en somme, pour peu que nos attentes frôlent l'herbe la plus rase... Et ça n'est pas fini, tant qu'on y est, puisqu'au cinéma il y a le son, autant faire passer ses chansons préférées du moment! Attends que je sorte mon ipod, hop, et voilà! Et puis autant faire poser, hum, jouer la famille et ses amis, plus on est de fous! Qu'est-ce donc que « Marie Antoinette » au final? Une petite bulle de savon (rose) prête à éclater, un joli cliché tendance, pour l'instant à la mode mais voué à se défraichir bien rapidement dans notre société de l'art consommable/jetable. Juste parce que l'on a tendu une caméra à Sofia Coppola.«La beauté réside dans la vérité même de la vie, pour autant que l'artiste la découvre et l'offre fidèlement à la vision unique qui est la sienne.» Andreï Tarkovski, Le Temps Scellé (1989)
Pages
lundi 25 avril 2011
« Marie Antoinette » de Sofia Coppola (2005)
 Vous reprendrez bien un peu de ketchup avec vos macarons? L'histoire de Marie-Antoinette/Sofia Coppola est toute simple, elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment, en possession de moyens extraordinaires : ce n'est pas sa faute (sous-entendu qu'elle en ait usé de la sorte). Si je dois concéder une chose à Coppola-fille, c'est que le sujet de son film est limpide et en parfait accord avec lui-même, il constitue le summum du narcissisme artistique et de la frivolité avec ce zeste de mauvais conscience qui épice le tout, histoire de donner du grain à moudre à la critique : ce long métrage est très maladroit, filmé avec les pieds, creux mais un poil touchant (autant que peut l'être une petite fille qui s'amuse avec son jouet) et surtout cohérent, faut-il le descendre ou le louer? Le problème ne se poserait pas si l'on se souvenait que ça n'est pas la cohérence d'une oeuvre qui fait sa richesse, mais sa profondeur. Bref, passons. Ainsi donc elle n'y peut rien. Oui mais qu'elle éloigne son visage du miroir et elle verrait peut-être que personne ne l'y plaque, libre à elle d'agir à sa guise et de proposer véritablement quelque chose de consistant et d'artistique dans un long métrage digne de ce nom... Elle verrait que le mieux à faire était sans doute pour elle, et pour nous,... de ne rien faire, et surtout pas ce film. Décidément « Marie Antoinette » me plaît, car l'on y trouve tous les travers dans lesquels le septième art doit à mon sens se garder de plonger, s'il n'est pas déjà trop tard. Mais allons-y : tout d'abord et surtout, que de puérilité! Vous allez me dire que c'est le sujet. Et je vous répondrai, justement. Une puérilité savamment cultivée, une bêtise même que l'on rencontre partout : dans l'écriture des personnages, dans leur interprétation, dans les thèmes abordés (l'éternel passage à l'acte, l'oisiveté, les paradis artificiels, les excessives bonnes manières,...), mais aussi et en particulier dans la mise en scène du film. Notamment par cet amour du mauvais goût effrontément affiché, de l'anachronisme bien ostensible, rien de plus tendance d'ailleurs! Rien de mieux pour se figurer être une artiste, c'est s'assurer ainsi que les gens glousseront à la fin du film devant de telles bonnes idées! Les premières choses que l'on remarque sont en effet une composition du plan de temps à autres assez soignée et une photographie léchée, soit si l'on ajoute ce goût du pompier et du kitch les plus grossiers, l'équivalent cinématographique de l'« art » d'un certain David Lachapelle, soit un truc immonde assez drôle et ironique, que l'on pourrait prendre pour du « génie » avec un peu de naïveté et d'ignorance, mais qui relève surtout de la blague de potache, de l'enfantillage. Un pastiche divertissant en somme, pour peu que nos attentes frôlent l'herbe la plus rase... Et ça n'est pas fini, tant qu'on y est, puisqu'au cinéma il y a le son, autant faire passer ses chansons préférées du moment! Attends que je sorte mon ipod, hop, et voilà! Et puis autant faire poser, hum, jouer la famille et ses amis, plus on est de fous! Qu'est-ce donc que « Marie Antoinette » au final? Une petite bulle de savon (rose) prête à éclater, un joli cliché tendance, pour l'instant à la mode mais voué à se défraichir bien rapidement dans notre société de l'art consommable/jetable. Juste parce que l'on a tendu une caméra à Sofia Coppola.
Vous reprendrez bien un peu de ketchup avec vos macarons? L'histoire de Marie-Antoinette/Sofia Coppola est toute simple, elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment, en possession de moyens extraordinaires : ce n'est pas sa faute (sous-entendu qu'elle en ait usé de la sorte). Si je dois concéder une chose à Coppola-fille, c'est que le sujet de son film est limpide et en parfait accord avec lui-même, il constitue le summum du narcissisme artistique et de la frivolité avec ce zeste de mauvais conscience qui épice le tout, histoire de donner du grain à moudre à la critique : ce long métrage est très maladroit, filmé avec les pieds, creux mais un poil touchant (autant que peut l'être une petite fille qui s'amuse avec son jouet) et surtout cohérent, faut-il le descendre ou le louer? Le problème ne se poserait pas si l'on se souvenait que ça n'est pas la cohérence d'une oeuvre qui fait sa richesse, mais sa profondeur. Bref, passons. Ainsi donc elle n'y peut rien. Oui mais qu'elle éloigne son visage du miroir et elle verrait peut-être que personne ne l'y plaque, libre à elle d'agir à sa guise et de proposer véritablement quelque chose de consistant et d'artistique dans un long métrage digne de ce nom... Elle verrait que le mieux à faire était sans doute pour elle, et pour nous,... de ne rien faire, et surtout pas ce film. Décidément « Marie Antoinette » me plaît, car l'on y trouve tous les travers dans lesquels le septième art doit à mon sens se garder de plonger, s'il n'est pas déjà trop tard. Mais allons-y : tout d'abord et surtout, que de puérilité! Vous allez me dire que c'est le sujet. Et je vous répondrai, justement. Une puérilité savamment cultivée, une bêtise même que l'on rencontre partout : dans l'écriture des personnages, dans leur interprétation, dans les thèmes abordés (l'éternel passage à l'acte, l'oisiveté, les paradis artificiels, les excessives bonnes manières,...), mais aussi et en particulier dans la mise en scène du film. Notamment par cet amour du mauvais goût effrontément affiché, de l'anachronisme bien ostensible, rien de plus tendance d'ailleurs! Rien de mieux pour se figurer être une artiste, c'est s'assurer ainsi que les gens glousseront à la fin du film devant de telles bonnes idées! Les premières choses que l'on remarque sont en effet une composition du plan de temps à autres assez soignée et une photographie léchée, soit si l'on ajoute ce goût du pompier et du kitch les plus grossiers, l'équivalent cinématographique de l'« art » d'un certain David Lachapelle, soit un truc immonde assez drôle et ironique, que l'on pourrait prendre pour du « génie » avec un peu de naïveté et d'ignorance, mais qui relève surtout de la blague de potache, de l'enfantillage. Un pastiche divertissant en somme, pour peu que nos attentes frôlent l'herbe la plus rase... Et ça n'est pas fini, tant qu'on y est, puisqu'au cinéma il y a le son, autant faire passer ses chansons préférées du moment! Attends que je sorte mon ipod, hop, et voilà! Et puis autant faire poser, hum, jouer la famille et ses amis, plus on est de fous! Qu'est-ce donc que « Marie Antoinette » au final? Une petite bulle de savon (rose) prête à éclater, un joli cliché tendance, pour l'instant à la mode mais voué à se défraichir bien rapidement dans notre société de l'art consommable/jetable. Juste parce que l'on a tendu une caméra à Sofia Coppola.samedi 23 avril 2011
« Le Silence » (Tystnaden) d'Ingmar Bergman (1963)
mercredi 20 avril 2011
« Immortel (ad vitam) » d'Enki Bilal (2004)
« Les Yeux clairs » de Jérôme Bonnell (2005)
lundi 18 avril 2011
« Akira » de Katsuhiro Ōtomo (1988)
samedi 16 avril 2011
« Nostalghia » d'Andreï Tarkovski (1983)
 « Nostalghia » est peut-être, sans en avoir l'air, le film le plus douloureux d'Andreï Tarkovski, celui où se concentre de la façon la plus évidente toute la tension de l'existence humaine. Il n'y a d'ailleurs pas à proprement parler d'intrigue, il s'agit plutôt de la retranscription imagée de la vie, cette éternelle attente où hommes et femmes, fous et sains d'esprits, étrangers ou autochtones, tous aspirent à combler un manque, leur manque, et à embrasser l'infini. La nostalgie en est la manifestation même : ce sentiment indicible et ô combien ambivalent, à la fois autodestructeur et source d'un doux réconfort, peut-être par trop illusoire... « Nostalghia » est bien le long métrage de l'irréconciliable ambiguïté terrestre... Mais il propose un chemin à suivre, une réelle issue, pour qui sait l'entr'apercevoir. « Nostalghia » est l'oeuvre d'un artiste et d'un homme au soir de sa vie, une oeuvre pleinement aboutie, magnifique, exceptionnellement riche, celle d'un maître du cinématographe. C'est aussi l'oeuvre d'un homme qui a eu le loisir de contempler toute la vanité humaine, tous les faux-semblants dont l'humanité se pare et dans lesquels elle s'enfonce toujours davantage pour mieux s'y perdre. Au premier rang desquels l'on trouve cette insatiable soif de matérialisme, qu'il dénoncera de manière encore plus vive et efficace dans « Le Sacrifice ». J'ai été particulièrement surpris de découvrir une nouvelle facette d'Andreï Tarkovski avec ce long métrage, on l'y découvre un peu plus charnel, sensible (cette bande-son! ces couleurs!), un peu plus amer, un peu plus drôle, un peu plus serein... Et toujours cette petite lueur d'espoir au milieu de l'immensité du monde... Incroyable comme il parvient à simplifier son art, le rendre plus clair, plus limpide, et à la fois plus riche, encore plus profond et touchant... Bref, un chef-d'oeuvre de plus pour cet extraordinaire cinéaste.
« Nostalghia » est peut-être, sans en avoir l'air, le film le plus douloureux d'Andreï Tarkovski, celui où se concentre de la façon la plus évidente toute la tension de l'existence humaine. Il n'y a d'ailleurs pas à proprement parler d'intrigue, il s'agit plutôt de la retranscription imagée de la vie, cette éternelle attente où hommes et femmes, fous et sains d'esprits, étrangers ou autochtones, tous aspirent à combler un manque, leur manque, et à embrasser l'infini. La nostalgie en est la manifestation même : ce sentiment indicible et ô combien ambivalent, à la fois autodestructeur et source d'un doux réconfort, peut-être par trop illusoire... « Nostalghia » est bien le long métrage de l'irréconciliable ambiguïté terrestre... Mais il propose un chemin à suivre, une réelle issue, pour qui sait l'entr'apercevoir. « Nostalghia » est l'oeuvre d'un artiste et d'un homme au soir de sa vie, une oeuvre pleinement aboutie, magnifique, exceptionnellement riche, celle d'un maître du cinématographe. C'est aussi l'oeuvre d'un homme qui a eu le loisir de contempler toute la vanité humaine, tous les faux-semblants dont l'humanité se pare et dans lesquels elle s'enfonce toujours davantage pour mieux s'y perdre. Au premier rang desquels l'on trouve cette insatiable soif de matérialisme, qu'il dénoncera de manière encore plus vive et efficace dans « Le Sacrifice ». J'ai été particulièrement surpris de découvrir une nouvelle facette d'Andreï Tarkovski avec ce long métrage, on l'y découvre un peu plus charnel, sensible (cette bande-son! ces couleurs!), un peu plus amer, un peu plus drôle, un peu plus serein... Et toujours cette petite lueur d'espoir au milieu de l'immensité du monde... Incroyable comme il parvient à simplifier son art, le rendre plus clair, plus limpide, et à la fois plus riche, encore plus profond et touchant... Bref, un chef-d'oeuvre de plus pour cet extraordinaire cinéaste.« Un Prophète » de Jacques Audiard (2009)
vendredi 15 avril 2011
« Les Amants du Pont-Neuf » de Leos Carax (1991)
jeudi 14 avril 2011
« L'Ange exterminateur » (El Ángel exterminador) de Luis Buñuel (1962)
mercredi 13 avril 2011
« City Girl » de Friedrich Wilhelm Murnau (1930)
mardi 12 avril 2011
« Interstella 5555 » de Leiji Matsumoto (2003)
dimanche 10 avril 2011
« At Land » de Maya Deren (1944)
samedi 9 avril 2011
« Black Swan » de Darren Aronofsky (2011)
« Meshes of the Afternoon » de Maya Deren (1943)
lundi 4 avril 2011
« The Brown Bunny » de Vincent Gallo (2004)

Un homme, Bud Clay, traverse les Etats-Unis pour rentrer chez lui et rejoindre sa femme Daisy. En chemin, il aborde des femmes au nom de fleurs, puis les abandonne, ne cherchant visiblement qu’à retrouver l’image de Daisy (Marguerite) à travers ces visages d’inconnues. Plus il se rapproche de sa destination, plus il semble souffrir. Des visions d’instants passés avec sa femme l’envahissent, des larmes coulent sur son visage. On soupçonne que quelque chose a mal tourné, on pense à une séparation brutale, à l’image du couple Travis/Jane de « Paris Texas », que le film de Gallo nous évoque à plusieurs reprises. Bud et Travis semblent atteint du même mal. Un fantôme les hante, fantôme qu’ils finiront par retrouver, soit pour se libérer (Travis), soit pour définitivement s’oublier (Bud, devenant fantôme lui-même). A sa sortie, le film de Gallo avait fait couler beaucoup d’encre. Les commentaires avaient été nombreux et passionnés, principalement axés autour de la personnalité du réalisateur-à-tout-faire Gallo (sur laquelle nous ne nous arrêterons pas), mais trop rarement portés sur ce qui compte vraiment, à savoir les qualités artistiques éventuelles du film. « The Brown Bunny » est un film d’une grande simplicité, simplicité dont il tire à la fois ses forces et ses faiblesses. Là où Wenders utilisait un outil scénaristique, à savoir le mutisme, pour marquer la séparation de Travis du monde extérieur, Gallo utilise davantage les moyens du cinéma (même si l’on ne peut pas négliger son interprétation), jouant intelligemment sur quelques idées et principes de mise en scène, en cloisonnant Bud dans des espaces fermés (le principal étant sa fourgonnette) qui semblent de jamais communiquer avec l’extérieur. En revanche, la simplicité des moyens utilisés n’obligeait aucunement à une certaine négligence dans la réalisation. La première séquence, où le cameraman filme une course de moto caméra à l’épaule (qu’on imagine plutôt à bout de bras dans le cas présent), est irregardable, et de manière générale, dès que la caméra est portée, c’est un supplice visuel (Gallo peut tout de même s’offrir un stabilisateur léger non ?). La pertinence de certains plans fixes, comme ceux filmés à l’intérieur du véhicule et qui reposent sur une idée précise de mise en scène, laisse trop apparaître, par contraste, l’absence d’idées pour soutenir d’autres plans qui semblent bâclés. Passées ces remarques générales, il faut s’attarder sur la longue séquence finale, sommet émotionnel du film mais aussi révélation trop explicative et appuyée du mystère de la relation Bud/Daisy. On a beaucoup commenté cette fellation non simulée (principal objet du scandale cannois), scène quasi pornographique (mais jamais érotique, créant une distance désexualisante). Passés les jugements passionnés hâtifs, il est nécessaire de s’interroger sur la pertinence de cette scène explicite. Et il faut bien reconnaître qu’elle participe pleinement de la force de la séquence, dont on ressort quelque peu exténué. Alors certes, un Bergman n’aurait eu nul besoin de s’appuyer sur un tel dispositif pour obtenir une puissance de l’émotion encore bien supérieure et se serait contenté de son écriture, du texte et de l’interprétation de ses comédiens. Mais n’est pas Bergman qui veut ! Gallo réalise ici un film à fleur de peau (chose suffisamment rare dans le cinéma américain pour être signalée), un film travaillé d’une détresse et d’une émotion palpable. Trop palpable peut-être pour certains critiques et journalistes peu habitués, qui s’y sont probablement brûlés.
[2/4]