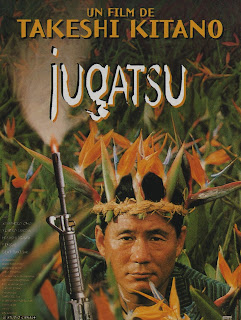«La beauté réside dans la vérité même de la vie, pour autant que l'artiste la découvre et l'offre fidèlement à la vision unique qui est la sienne.» Andreï Tarkovski, Le Temps Scellé (1989)
mercredi 13 juillet 2011
« L'Eternité et un jour » (Mia eoniótita ke mia méra) de Theo Angelopoulos (1998)
dimanche 10 juillet 2011
« Le Regard d'Ulysse » (To Vlemma tou Odyssea) de Theo Angelopoulos (1995)
lundi 4 juillet 2011
« Bouge pas, meurs et ressuscite » (Zamri, umri, voskresni!) de Vitali Kanevski (1989)
samedi 2 juillet 2011
« Pink Floyd : The Wall » d'Alan Parker (1982)
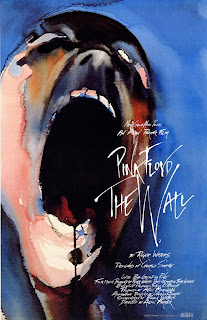 Il est indéniable que ce film démontre une grande ambition de la part de Roger Waters et Alan Parker. Sa structure même, les thèmes qu'il aborde, les différentes techniques utilisées lui donnent une ampleur certaine. Et il faut bien le dire, son propos reste, du moins pour une part, encore d'actualité, quant à cet enfermement dans une société qui emmure en lui-même l'individu, pour n'en faire plus qu'une sorte de consommateur passif, « confortablement engourdi ». « The Wall » comporte donc d'excellents passages, terrifiants, et qui plus est accompagnés d'une bande-son connue de tous, appréciable dans ses meilleurs moments. Voilà pour les qualités de ce long métrage. Maintenant, si l'on s'attarde sur les défauts l'on ne peut que regretter la surabondance d'effets, de passages outranciers pas du meilleur goût, et autres clichés qui plombent la qualité du film dans son ensemble, qui reste très morcelé en passages différemment réussis... Rien que la bande-son, l'album des Pink Floyd, est inégale : à mon sens c'est loin d'être leur meilleur opus. A l'image du film, il s'agit avant tout d'un concept, et c'est trop souvent l'idée qui prime sur l'art, un regard sur la société et soi-même exprimé avec une certaine acuité, mais qui se fond fort mal dans des images et des sons dénués trop souvent d'une quelconque retenue ou beauté. « The Wall » est très daté : certes les thèmes qui le traversent ont quelque peu traversé le temps, mais son esthétique typique des années 80, sa symbolique franchement lourde, et finalement sa forme en font une curiosité qui vaut le détour, voire un sympathique essai, mais pas grand chose de plus...
Il est indéniable que ce film démontre une grande ambition de la part de Roger Waters et Alan Parker. Sa structure même, les thèmes qu'il aborde, les différentes techniques utilisées lui donnent une ampleur certaine. Et il faut bien le dire, son propos reste, du moins pour une part, encore d'actualité, quant à cet enfermement dans une société qui emmure en lui-même l'individu, pour n'en faire plus qu'une sorte de consommateur passif, « confortablement engourdi ». « The Wall » comporte donc d'excellents passages, terrifiants, et qui plus est accompagnés d'une bande-son connue de tous, appréciable dans ses meilleurs moments. Voilà pour les qualités de ce long métrage. Maintenant, si l'on s'attarde sur les défauts l'on ne peut que regretter la surabondance d'effets, de passages outranciers pas du meilleur goût, et autres clichés qui plombent la qualité du film dans son ensemble, qui reste très morcelé en passages différemment réussis... Rien que la bande-son, l'album des Pink Floyd, est inégale : à mon sens c'est loin d'être leur meilleur opus. A l'image du film, il s'agit avant tout d'un concept, et c'est trop souvent l'idée qui prime sur l'art, un regard sur la société et soi-même exprimé avec une certaine acuité, mais qui se fond fort mal dans des images et des sons dénués trop souvent d'une quelconque retenue ou beauté. « The Wall » est très daté : certes les thèmes qui le traversent ont quelque peu traversé le temps, mais son esthétique typique des années 80, sa symbolique franchement lourde, et finalement sa forme en font une curiosité qui vaut le détour, voire un sympathique essai, mais pas grand chose de plus...vendredi 1 juillet 2011
« Tomboy » de Céline Sciamma (2011)
jeudi 30 juin 2011
« Le Narcisse noir » (Black narcissus) de Michael Powell et Emeric Pressburger (1947)
« The Tree of life » de Terrence Malick (2011)
lundi 27 juin 2011
« Le 25 octobre - Premier jour » (25-е - pervyi den) de Youri Norstein et Arkadi Tiourine (1968)
« Jugatsu » (3-4x jugatsu) de Takeshi Kitano (1990)
samedi 18 juin 2011
« New Rose Hotel » d'Abel Ferrara (1998)
jeudi 16 juin 2011
« Le Labyrinthe de Pan » (El laberinto del fauno) de Guillermo del Toro (2006)
mardi 14 juin 2011
« Une femme est une femme » de Jean-Luc Godard (1961)
dimanche 12 juin 2011
« Athènes, retour à l’Acropole » (Athina, epistrofi stin Akropoli) de Theo Angelopoulos (1983)

«Athènes, retour à l’Acropole» commence exactement là où s’arrêtait «Alexandre le Grand», par le même plan : un vaste panoramique de la capitale grecque s’achevant sur une vue de l’Acropole. Ce moyen métrage est un poème d’Angelopoulos sur sa ville natale, réalisé dans le cadre d’une série de documentaires télévisés sur les capitales européennes. Le film n’a donc ni l’ambition, ni l’ampleur des films précédents du cinéaste, mais n’en n’est pas pour autant insignifiant. «Athènes, retour à l’Acropole», est une transition dans la filmographie d’Angelopoulos, transition vers la forme plus élégiaque des films à venir. Après la quête d’identité du cinéaste menée dans l’histoire passée de son pays, le film marque également le passage au temps présent. Angelopoulos filme sa ville en poète, usant de longs travellings et de lents panoramiques qui viennent illustrer et faire le contrepoint aux commentaires en voix off. Ces commentaires se composent d’anecdotes personnelles et de souvenirs d’enfance du cinéaste, mais aussi de récits historiques, ponctués par des lectures de poèmes de Georges Séféris. L’Histoire de la Grèce et de la ville se mélange à l’histoire du cinéaste, annonçant l’orientation nouvelle du cinéma d’Angelopoulos, davantage focalisé sur les histoires individuelles et la condition humaine. Le film continue néanmoins de creuser le sillon des liens entre passé et présent, la caméra cherchant dans l’Athènes contemporaine les traces du passé, depuis les ruines de l’Antiquité jusqu’aux marques de la guerre laissées sur les façades des maisons. Angelopoulos raconte que sa maison natale a été détruite pour laisser place aux fouilles archéologiques. Juste sous sa chambre d’enfant, sous une certaine couche de terre, les archéologues ont découvert les vestiges d’une chambre antique avec des jouets indiquant qu’y dormait un petit enfant. Cette image poétique d’une circularité de l’Histoire est une belle illustration du sens de «Athènes, retour à l’Acropole». On regrettera l’omniprésence de la voix off qui, pour un spectateur n’entendant pas le grec, oblige à lire constamment les sous-titres, ne permettant pas d’apprécier pleinement l’image et rendant délicate l’immersion dans le film. Ca ne vaut pas une élégie sokourovienne (le cinéaste russe est l’un des rares à exceller dans ce registre), mais on peut facilement se laisser bercer par ce poème visuel. Restons objectif cela dit, «Athènes, retour à l’Acropole» reste une transition dans le parcours du cinéaste, une étape qu’on oubliera vite.
[1/4]
vendredi 3 juin 2011
« Traité de bave et d'éternité » d'Isidore Isou (1951)
jeudi 19 mai 2011
« Essential Killing » de Jerzy Skolimowski (2011)

«Essential Killing», c’est la mise en images d’une traque, celle d’un afghan (interprété par l’acteur américain Vincent Gallo) pourchassé par une armée américaine qu’on entend plus qu’on ne voit. L’homme est d’abord arrêté en plein désert afghan. Il est ensuite conduit dans une prison secrète, mais parvient à s’échapper durant le transfert. Dans cette première partie, Skolimowski parvient efficacement à contextualiser et à poser les enjeux de son film, par l’utilisation de symboles visuels forts. C’est ainsi qu’il lui suffit de convoquer l’uniforme orange et la cagoule blanche de Guantanamo pour suggérer les tortures infligées au prisonnier. Mais la critique de la politique étrangère américaine n’est pas ce qui intéresse ici Skolimowski, qui passe rapidement, en quelques plans, sur cet aspect, pour se focaliser sur la traque de ce fugitif dans les forêts enneigées d’un pays non identifié. La fuite de cet homme, réduit à l’instinct animal (survivre au froid, se nourrir), prend rapidement les allures d’un véritable chemin de croix, jalonné d’épreuves caractérisées par un fort symbolisme judéo-chrétien. Et c’est là que le film ne fonctionne pas. Tout d’abord, cette construction du film par succession d’épreuves tue dans l’œuf la tentative de Skolimowski d’illustrer l’animalité du personnage et le côté instinctif de sa lutte pour la survie. Comment cette fuite pourrait-elle être instinctive alors que Skolimowski est là, derrière chaque arbre de cette forêt, pour tendre un nouveau piège symbolique à son personnage?... Non seulement cela nuit à la vraisemblance de l’ensemble, jusqu’à en devenir presque risible (l’homme marche dans un piège à loup, mange des baies toxiques, se couche à l’endroit précis où tombe l’arbre scié par un bûcheron…), mais cette succession d’épreuves est purement théorique : elle cherche à faire du traqué un martyr. Dès lors le film se révèle froid, distant. Les images se vident de toute densité émotionnelle et le personnage s’avère bien plus déshumanisé par l’arsenal théorique mis en place par Skolimowski que par la situation qu’il vit. Il devient lui aussi symbole. De plus, le symbolisme de certaines situations peut s’avérer parfois grossier (la scène où il force une femme allaitant son enfant à lui donner le sein est ridicule). Il a été dit que le film était «radical» dans son parti pris et sa mise en scène. A mon goût, il ne l’est pas assez, ou, tout du moins, il n’assume pas pleinement sa radicalité. Skolimowski se sent comme obligé d’introduire des séquences de flash-back pour construire un passé et une vie à son personnage, séquences non seulement superflues mais particulièrement vilaines visuellement. Au final, on retiendra 2 scènes qui parviennent un peu à s’extraire de la rigidité théorique de l’ensemble et à proposer un début d’émotion artistique : la séquence des chiens et le dernier plan du film, d’une sobriété salutaire. Ca reste léger…
[1/4]
lundi 16 mai 2011
« Elvira Madigan » de Bo Widerberg (1967)

Il est drôle de lire les critiques de Bo Widerberg à l’encontre du cinéma de son compatriote Bergman, qu’il qualifiait de «vide», après avoir vu «Elvira Madigan». Car s’il est bien un film vide de contenu et de substances, c’est bien celui-ci! Je découvre avec ce film le cinéma de Widerberg et je peux dire que j’aurai bien du mal à trouver la motivation pour en voir un autre… «Elvira Madigan» est une succession de plans (pas moches, certes) d’un homme et d’une femme s’enlaçant dans les herbes hautes, à la belle saison, au son du concerto pour piano n°21 de Mozart. Ils s’aiment, mais ils n’ont pas le droit de s’aimer (lui a déserté l’armée et quitté sa femme et son enfant pour vivre la robinsonnade avec la belle Elvira). Leur petite escapade romantique dans les champs se terminera mal, sans que nos deux gentils amoureux n’aient cherché le moins du monde à s’en tirer. On peut y voir la version soft, proprette et en costumes de «La ballade sauvage» de Malick, l’ennui en plus. Widerberg voulait insuffler un air de renouveau, un «coup de jeune» dans le cinéma suédois, en s’inspirant du cinéma de Truffaut (il aurait mieux fait de regarder du côté de Godard ou de Resnais) et de Cassavetes. De Truffaut, il a gardé le classicisme plat, et de Cassavetes, une certaine manière de filmer, en gros plans et caméra à l’épaule, les corps-à-corps de ses personnages. Reste Pia Degermark, actrice à la beauté assez remarquable, qui a d’ailleurs obtenu un prix d’interprétation à Cannes (prix très sexiste cela dit, tant l’actrice est juste filmée mais ne joue en aucune façon, son texte tenant vraisemblablement sur une seule page). Même si le film évite les écueils redoutés (pathos, romantisme pseudo-désespéré) grâce à une réalisation plutôt sobre, on peine à trouver intérêt à suivre les déboires amoureux de ces deux mannequins. Belles images et belle actrice ne suffisent pas à faire un bon film. Widerberg reprochait à Bergman de monopoliser la production cinématographique suédoise et d’être l’arbre qui cachait la forêt. Après ce premier visionnage d’un film de Widerberg, Bergman reste pour l’instant l’arbre au milieu de la prairie.
[1/4]
dimanche 1 mai 2011
« Memories » (Memorîzu) de Kōji Morimoto, Tensai Okamura et Katsuhiro Ōtomo (1995)
dimanche 10 avril 2011
« At Land » de Maya Deren (1944)
samedi 9 avril 2011
« Meshes of the Afternoon » de Maya Deren (1943)
mardi 29 mars 2011
« L'Etrange affaire Angélica » (O estranho caso de Angélica) de Manoel de Oliveira (2011)
[1/4]