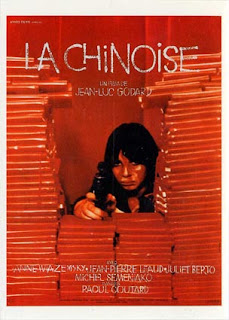Fra Angelico, L'Annonciation de Cortone, (1433-1434)
* * *
Arcabas, L'Annonce faite à Marie, (deuxième moitié du XXe siècle)
© ADAGP, Paris 2013
Fra Angelico et Arcabas sont deux peintres d'art sacré. Le premier, religieux dominicain italien, est l'une des figures de la peinture occidentale du Quattrocento. Le frère angélique avait un « talent rare et parfait » nous dit Vasari, célèbre biographe des plus grands peintres de la Renaissance. Ses peintures sont en effet d'une luminosité radieuse et d'une douceur sans pareille. Il célèbre par son art la beauté de l'homme et de la femme : comment ne pas être ému par la finesse avec laquelle il dépeint les traits humains ? Un autre de ses grands talents est la maîtrise des couleurs : son bleu est magnifique, profond, son rouge est vif et splendide, et le doré vient rehausser l'éclat de ses toiles et de ses fresques.
Arcabas est un artiste contemporain français, né en 1926, en Lorraine. Établi aujourd'hui en Isère, il réalise aussi bien des toiles que des vêtements, des sculptures ou des vitraux. Tantôt profane tantôt religieuse, son œuvre est toute entière traversée par le sentiment du sacré de la Création. C'est donc avec une joie communicative qu'Arcabas représente les figures bibliques traditionnelles, l'être humain, mais aussi des scènes du quotidien, ou même son état et son atelier d'artiste. Surnommé parfois le peintre de l'âme, c'est en toute modestie qu'il apporte sa pierre à l'édifice de la peinture occidentale, et fait à ce titre figure d'exception dans le morne paysage de l'art contemporain, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs.
Les deux œuvres que je tiens à présenter conjointement me tiennent toutes deux à cœur. Ce sont en effet deux sommets de l'art de leurs auteurs, deux façons de faire totalement différentes (quoique ne manquant pas de points communs, nous le verrons) mais tout aussi inspirées et réussies. Ces deux tableaux évoquent la même scène, tirée de la Bible : l'Annonce faite à Marie qu'elle enfantera Jésus.
1) Le contexte
a) Fra Angelico
L'Annonciation de Fra Angelico naît à une époque ou l'art occidental prend son essor. En 1434, nous sommes au début de la Renaissance, l'homme devient le centre de l'univers : Erasme ou Galilée ne sont pas encore nés, les Amériques ne sont pas encore découvertes, mais déjà l'ordre du monde est chamboulé. L'humanisme est né à la suite de Pétrarque, et Giotto a révolutionné la représentation picturale occidentale. La perspective fait son entrée dans la peinture, et Fra Angelico effectuera la synthèse des avancées techniques les plus récentes et de la tradition de l'art occidental.
Fra Angelico est le contemporain de Cosme de Médicis, riche mécène fondateur de la dynastie éponyme, et fera son apprentissage à Florence. L'Italie est alors l'un des pays les plus florissants d'Europe, et Florence, l'une des villes les plus prestigieuses. Mais Fra Angelico fut certainement marqué tout autant par Thomas d'Aquin, tout bon dominicain qu'il était, et donc par la scolastique.
On retrouve en effet dans l'art de Fra Angelico l'expression pourrait-on dire des théories esthétiques du docteur angélique. C'est indubitablement le maître de l'harmonie, de la perfection, de la clarté des formes et des couleurs.
b) Arcabas
Arcabas est quant à lui un homme du XXème siècle. Enrôlé de force à 17 ans dans la Wehrmacht, par les Allemands qui ont annexé la Lorraine, il s'échappe pour regagner Paris et s'inscrire aux Beaux-Arts. Mais plus qu'à l'Académie, c'est sous l'égide de son maître Clément Kieffer, côtoyé plus jeune, qu'il apprend son métier de peintre.
Marqué par les deux Guerres mondiales, le XXème siècle est celui de l'effondrement de l'art. Si l'on ne peut nier la présence de paillettes d'or, notamment dans le cinéma, le nihilisme et la désespérance la plus sombre caractérisent ce siècle, à l'opposé de l'éclat et de l'enthousiasme de la Renaissance.
Et pourtant, Arcabas a réussi à produire une œuvre vive, colorée, chatoyante, joyeuse, pleine d'espoir et d'humanité. Croyant inlassablement en la beauté (contrairement à nombre de ses contemporain gênés par ce mot), le peintre français s'inspire aussi bien de Piero della Francesca que de Picasso. Il a ainsi assimilé une autre révolution picturale, celle de l'art abstrait et du cubisme, sans pour autant se laisser dominer par cette approche singulière.
2) Le sujet
L'Annonciation est ce passage de la Bible où l'ange Gabriel vient visiter Marie pour la prévenir qu'elle enfantera un fils du Seigneur : Jésus. Promise à Joseph, ne sachant pas comment une telle chose peut être possible, Marie est surprise, mais elle accepte la volonté de Dieu. « Je suis la servante du Seigneur », lui répond-elle.
C'est un passage clé des Écritures, où Marie fait preuve d'audace et de confiance dans la capacité du Seigneur à vouloir le bien et à faire l'impossible. Marie devient alors la figure de la mère, qui se réjouit à l'idée d'être enceinte, mais aussi celle de la femme, courageuse face aux épreuves de la vie. Joseph est en effet son époux, et il peut la répudier s'il découvre qu'elle attend un enfant qui n'est pas de lui. Averti en songe, Joseph décidera finalement de garder Marie comme épouse, et élèvera Jésus comme son propre fils.
Voici un extrait de Wikipédia, qui explique bien la symbolique à l’œuvre dans les traditionnelles représentations picturales de l'Annonciation :
« Bien qu'aucun des Évangiles ne mentionne ce que faisait Marie au moment de l'Annonciation, deux traditions picturales se sont dégagées néanmoins dans l'art chrétien : dans la première et la plus ancienne, qui est essentiellement illustrée par le christianisme oriental, Marie est représentée filant de la laine. En revanche, dans de nombreuses représentations de l'Annonciation de l'art occidental, particulièrement depuis Duccio qui est le premier à adopter cette iconographie, Marie est représentée généralement avec un livre ouvert à la main. Le livre, que Marie tient à la main, traduit son origine lettrée et donc sa connaissance des Saintes Écritures : Marie est le modèle de la confiance en Dieu par excellence. Saint Bonaventure identifie le passage lu comme les prophéties d'Isaïe, qui annoncent justement la venue du Christ. »
3) Analyse conjointe et comparaison
a) Les lignes de force, la structure
Hasard ou non, les deux tableaux d'Arcabas et de Fra Angelico sont symétriquement opposés en ce qui concerne leur organisation. Marie est à droite chez Fra Angelico, et à gauche chez Arcabas. Pour autant, l'ange Gabriel et Marie sont dans les deux cas à la même hauteur, comme pour instaurer un dialogue.
Dans les deux tableaux, l'ange a une posture humble : il est courbé chez Fra Angelico, et pose un genou à terre chez Arcabas. Le groupe formé par Gabriel et Marie est plus dense chez Fra Angelico : la ligne de force que représente le corps de l'ange est quasiment verticale et forme avec celui de Marie une sorte de triangle homogène.
Chez Arcabas, en revanche, le corps de l'ange amène directement le regard vers le visage de Marie.
Chez Fra Angelico il y a donc deux personnes qui conversent, l'ange qui annonce à Marie qu'elle va enfanter un fils de Dieu, et Marie qui accepte le souhait de Dieu qu'elle soit mère (cet échange est d'ailleurs matérialisé par les paroles d'or émanant de Gabriel et de Marie). Chez Arcabas, l'ange est là pour Marie, tout son être de messager est tourné vers la destinataire de la parole de Dieu, la future mère de Jésus. Il sert davantage d'intermédiaire, et malgré sa taille imposante, il se met au chevet de Marie.
Notons qu'à la différence d'Arcabas, le tableau de Fra Angelico présente d'autres personnages, Adam et Ève, chassés du jardin d’Éden. La perspective du bâtiment, à gauche du tableau, dirige notre regard vers eux.

b) Les attitudes des personnages
Les personnages de Fra Angelico adoptent tous deux une attitude qu'on pourrait qualifier d'harmonieuse à la perfection, de sublime. L'ange pointe d'un doigt le ciel, de l'autre Marie, signe qu'elle sera visitée par le Seigneur. Il a une posture de messager, d'humble serviteur, pourtant irradiant de beauté. Marie fait un geste d'acceptation et de soumission, mais quel geste! Rien de déshonorant, de servile, de contrit : un geste d'acceptation douce et sereine, joyeuse même. Gabriel est pour sa part presque humain, tout aussi incarné que Marie. De larges auréoles dorées entourent leurs visages.
Chez Arcabas, l'attitude est tout autre. Ici Marie est quelque peu surprise, son air est interrogatif : elle était en train de lire les Écritures. On sent l'irruption de l'ange dans sa vie, dans son quotidien. Sa tête est donc détournée du livre, et sa main, arrêtée dans une pose peu naturelle, vient accentuer cet air surpris. Marie est ici beaucoup plus spontanée, moins hiératique. Le tableau est indéniablement plus moderne. Gabriel, quant à lui, est irradiant de feu. C'est davantage un esprit que chez Fra Angelico. Notons que chez Fra Angelico aussi, Marie semblait en train de lire (un livre est posé sur sa jambe droite).
c) Les traits
Chez Fra Angelico, on lit la sérénité, la bienveillance, l'amour sur le visage de ses personnages. Les traits de Marie et de Gabriel sont extrêmement fins, et de toutes les Annonciations qu'il a peintes, c'est sans doute celle qui présente les visages les plus harmonieux (au diapason de la beauté de l'ensemble). Les mains elles aussi sont très fines, désignant délicatement le ciel et Marie pour l'ange, et celles de la Vierge doucement posées sur ses épaules, en signe d'humble soumission.
Chez Arcabas, Marie est beaucoup plus présente, franche, mais tout autant dans une attitude d'acceptation, quoique mêlée de surprise. Son visage semble dire sa volonté de suivre le Seigneur, dans la même joie que chez Fra Angelico. L'ange, quant à lui, a un regard plus intense. Arcabas utilise une de ses techniques favorites, reprise du cubisme et de Picasso : deux yeux côte à côte chez un personnage de profil, qui défient les lois de la nature, pour mieux signifier la force du regard de l'ange. Son visage enflammé traduit à la fois sa nature divine, spirituelle, et la vivacité du message qu'il porte à Marie.
d) Les couleurs
On retrouve chez Fra Angelico et chez Aracabas des codes de couleurs traditionnels. Ainsi Marie est peinte en jaune, rouge et bleu chez les deux artistes, comme dans nombre de tableaux occidentaux représentant le personnage de la Vierge. Notons que Marie et Gabriel sont tous deux blonds chez Fra Angelico, d'une blondeur presque irréelle, divine.
Ce qui diffère, en revanche, c'est tout d'abord la figuration de l'ange. Gabriel ressemble plus à un humain chez Fra Angelico, et sa robe est de couleur rose pale, couleur assez neutre mettant en valeur la splendeur des vêtements de Marie, peu sophistiqués (quoique bordés de doré) mais lumineux.
Chez Arcabas, Gabriel est doré et gris bleu. Difficile de séparer son être de ses habits, ce qui fait de lui un esprit évanescent, immatériel, vaporeux, au contraire de Fra Angelico.
Le décor est plus riche chez Fra Angelico que chez Arcabas : nous sommes dans une sorte de palais, sous une voûte étoilée d'un bleu noble, tandis que l'on aperçoit un jardin clos, symbole traditionnel de la virginité de Marie, au vert plein d'espérance. Des roses, signes de l'immaculée conception de la mère de Jésus, semblent y pousser au fond. A l'intérieur du bâtiment, de riches draperies entourent Marie, et mettent en valeur la scène, la meublent, quoique discrètement.
Chez Arcabas, le décor est réduit à l'extrême, abstrait. Seul un carrelage noir et blanc fait office de plancher, sous un fond rouge.
Conclusion
Nous avons ici affaire à deux chefs-d’œuvre de la représentation picturale occidentale, merveilles de composition et d'imagination. Arcabas est ici particulièrement inspiré, très original (comme pour nombre de ses réalisations), tandis que Fra Angelico atteint des sommets d'harmonie et de beauté. Arcabas n'est pas en reste ceci dit : Marie et Gabriel sont magnifiques, l'une est très belle, très féminine, l'autre est flamboyant.
Ces tableaux dépeignent des sentiments très subtils : la libre acceptation de Marie de suivre le Seigneur, l'annonce qu'elle enfantera un fils à l'avenir extraordinaire. Ces œuvres respirent la confiance, la joie, la sérénité, dans une grande simplicité. Nous sommes loin de l'exubérance baroque! Et pourtant, c'est splendide : nul besoin d'en faire trop. Il faut dire qu'Arcabas et Fra Angelico sont des maîtres : en quelque traits bien choisis, ils parviennent à représenter l'indicible.
Malgré la distance temporelle qui les sépare, Arcabas et Fra Angelico partagent ainsi une même vision de l'homme, distinguée, pleine de bonté et d'espoir. On retrouve dans leurs œuvres respectives une même sensibilité particulièrement délicate, au service de représentations principalement inspirées par la Bible. Une façon de rafraichir les images si riches des Écritures, de se les approprier pour mieux en faire ressortir toute la beauté.
[4/4]