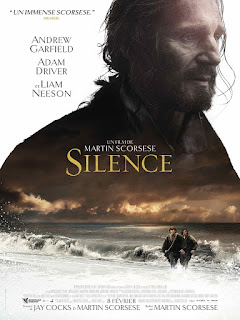« Princesse Mononoké » couronne la carrière d'Hayao Miyazaki par bien des aspects. Peut-être son film le plus riche et le plus complexe, c'est également l'un des plus accomplis formellement, utilisant à merveille les possibilités de l'art du dessin animé fait main, avec un soupçon d'images de synthèse uniquement quand le besoin se fait sentir, pour ne pas rompre l'équilibre de la façon de faire typiquement artisanale du fameux studio Ghibli. Je ne m'attarderai pas sur la richesse de l'univers miyazakien, sur l'abondance des kamis et autres êtres fantastiques qui font tout le charme du long métrage, et plus généralement de l’œuvre même de Miyazaki. Je fais en revanche le choix de me pencher sur « l'infrastructure » de ce film, à savoir ses 3 dimensions (me semble-t-il) : sociologique, poétique et épique.
Sociologique, tout d'abord, car le grand « thème » si j'ose dire de « Princesse Mononoké », c'est l'antagonisme entre tradition et modernité. Deux esprits s'affrontent : celui des anciens, du culte des divinités shintoïstes, du respect de l'Autre et de la nature ; et celui des modernes, de l'emprise sur la nature, mais aussi de la rupture avec les traditions asservissantes, d'une liberté chèrement gagnée. Deux figures s'opposent ainsi dans ce long métrage : San, la princesse Mononoké, c'est-à-dire des esprits vengeurs (si j'en crois Wikipédia), qui vit auprès des animaux-dieux de la forêt magique (une déesse louve l'a recueillie à la mort de ses parents et en a fait sa fille adoptive), et pour qui l'homme est un monstre cupide et violent, qui ne pense qu'à tuer et détruire, notamment la nature ; et de l'autre côté Dame Eboshi, mystérieuse aventurière qui règne en maître sur des forges rougeoyantes, d'où est extrait le métal utilisé par les armes à feu qui ravagent les animaux divins. Ce personnage est particulièrement réussi, car s'il a un côté obscur, du fait de son avidité et de son absence de scrupules, c'est également quelqu'un qui vit aux côté des lépreux, et qui a redonné une fierté et une dignité aux ex-prostituées qu'elle emploie dans ses forges. C'est le personnage moderne par excellence, du fait de son audace (elle ose rien moins que s'attaquer en personne à des dieux), mais aussi du fait de son féminisme : qu'une femme dirige un village, une entreprise industrielle mais aussi une armée d'hommes, qu'elle aille aux devants des combats, qu'elle ait la maîtrise de sa destinée et de celle de ses sujets, c'est bien évidemment une invention de Miyazaki, mais qui dit tout de ce que peut représenter l'émancipation de la femme dans un Japon très codifié (cf. les films de Masaki Kobayashi des années 60). Au milieu de ces deux personnages se trouve Ashitaka (alter-ego de Miyazaki ?), jeune prince qui veut porter un regard sans haine sur le monde qui l'entoure. Véritable médiateur, s'il veut stopper la folie meurtrière des hommes, et intimer à Dame Eboshi de respecter la nature et ses divinités, il ne peut se résoudre à tourner le dos à son humanité, et fait tout pour que San redevienne humaine, mais aussi pour que les gens de Dame Eboshi (et elle-même) ne subissent pas la fureur des dieux de la forêt. Plus complexe qu'il en a l'air, c'est l'un des rares héros masculins de la filmographie de Miyazaki, et c'est véritablement la clé de ce film. Car la grande force de ce long métrage, c'est que Miyazaki ne juge pas ses personnages, et ainsi ne porte pas de jugement sur le passage de la tradition à la modernité : l'ancien temps n'est pas le Bien et le nouveau le Mal. La modernité succède à la tradition, et pour cela la détruit de l'intérieur. Un monde nouveau naît alors, un monde ou la nature n'a plus rien d'enchanteresse, où les animaux ne parlent plus. Un monde domestiqué, où l'homme règne en maître, un monde en 3 dimensions – celui que nous connaissons – où le sacré est absent (la 4ème dimension de ce film). D'autres de ses films viendront souligner combien tout n'est pas rose dans ce nouveau monde (« Le Voyage de Chihiro » pour ne citer que lui), et tout ce qu'il a perdu de l'ancien. D'ailleurs l'Esprit de la forêt est tellement beau qu'on comprend aisément combien une part de Miyazaki regrette le Japon de la tradition. Mais pour certains de ses aspects seulement ! Notamment le culte du respect.
J'en viens à l'aspect poétique de ce long métrage. Ce qui est évident, comme je le disais, c'est que l'ancien monde a son charme, et même beaucoup de charme, à travers les yeux de Miyazaki. Les nombreux kamis, et notamment les amusants sylvains, font tout le sel de « Princesse Mononoké », sans parler bien évidemment de l'Esprit de la forêt, au visage (car c'est plus un visage humain qu'animal) étonnamment beau et apaisant. La forêt est magnifiée, sorte de monde primitif et vierge de toute emprise humaine, espace foisonnant qui abrite toutes sortes d'êtres, des humains aux animaux en passant par les dieux et déesses qui protègent cet endroit sacré. Difficile de ne pas succomber à cette vision paradisiaque de la nature. Mais ce qui est très fort dans ce film, c'est que ce n'est pas forcément un but en soi, c'est une sorte de fond aux aventures des personnages, et notamment de l'histoire d'amour qui unit Ashitaka à San. San est pleine de rage, elle en veut aux humains de détruire son monde merveilleux, de fouler au pied un univers qu'ils ne cherchent même pas à comprendre. C'est pour cela que dans un premier temps elle est hostile à Ashitaka, qui incarne le genre humain à lui seul. Mais elle va comprendre toute la bonté de cet être, qui au-delà de porter un regard dénué d'animosité, porte un véritable regard d'amour sur ceux qui l'entourent. Il aime profondément San, mais il aime aussi Dame Eboshi et ses gens, en tant qu'êtres humains méritant eux-aussi son respect. Car c'est là la condition de l'homme, soumettre la nature (dans une certaine mesure) pour pouvoir y vivre. San a oublié que c'était à elle aussi sa condition, et Ashitaka tente de lui faire entendre raison, non pas pour soumettre à son tour la nature et ceux qui l'ont recueillie, mais pour ré-apprendre à aimer les humains, qui s'ils cherchent à maîtriser la nature le font non pas par plaisir finalement, mais parce qu'il en va de leur survie. « Princesse Mononoké » est donc également une très belle histoire d'amour... impossible. Les scènes « d'affrontement » entre Ashitaka et San sont à ce titre très belles et émouvantes. Il y a beaucoup de poésie chez Miyazaki dans les relations humaines, c'est l'un des rares créateurs contemporains à encore croire en l'amour, ce qu'il a illustré à plusieurs reprises tout au long de sa filmographie, et une fois encore, de façon originale, ici.
Enfin, le registre épique. « Princesse Mononoké » est un grand voyage initiatique, notamment pour Ashitaka. En effet, s'il ne va pas forcément se révéler à lui-même, car il fait preuve dès le début d'une très grande maturité et d'un calme olympien, il va devoir conserver sa retenue, sa maîtrise de soi, face au mal qui le ronge et à la bêtise des hommes. Maudit par un dieu devenu démoniaque, qu'il a tué pour sauver son village d'origine, Ashitaka n'a d'autre choix que de quitter les siens pour s'aventurer à la recherche d'un remède. A de nombreuses reprises, il va devoir faire taire sa colère, pour ne pas qu'elle se transforme en haine et le tue de l'intérieur. Il aura bien des raisons de le faire, mais à chaque fois il saura se contenir, non sans que se matérialise ce combat intérieur, par ce bras traversé par cette cicatrice maudite. Signe de ce que la haine est un vrai poison pour l'homme ! Ashitaka le médiateur, mais aussi la première victime de ce combat entre tradition et modernité, va non seulement devoir affronter mais aussi absorber toute cette haine, et la transformer en amour et en sagesse. C'est probablement le personnage le plus « fort » de ce film, fort au sens où il se relèvera toujours de ses épreuves et saura se montrer exemplaire, tout comme Nausicaä dans la bande dessinée et le film éponymes, malgré toutes ses responsabilités. « Princesse Mononoké » est ainsi le récit de cette quête vers la guérison, qui ne sera possible qu'en détruisant la haine de ce monde. C'est aussi une authentique épopée en ce qu'elle rend compte des exploits des héros et des héroïnes de cette histoire. Entre batailles rangées et conflits intérieurs, Miyazaki illustre avec sa maestria habituelle les remous de l'Histoire, de cette transition entre deux mondes, entre des personnages aux visées contraires, mais aussi des drames intimes qui se nouent, et de la difficulté pour San et Ahsitaka d'accepter que leur monde change à jamais.
Il y a beaucoup de nostalgie dans ce long métrage mais aussi une certaine espérance. L'ancien monde a changé à jamais, tout retour en arrière sera impossible (et pas forcément souhaitable), c'est ce que Miyazaki nous montre par le simple biais d'images, à la fin de son film, non sans une certaine tristesse. En quelques plans, par cette herbe familière qui remplace la forêt sauvage et majestueuse, Miyazaki nous dit tout de ce passage d'une époque à une autre. Riche de thèmes et de personnages, illustré avec un talent inégalé, « Princesse Mononoké » n'est pas forcément son plus grand film à mon sens (la faute à un très relatif académisme), mais c'est indéniablement le plus représentatif de son talent. D'une profondeur que plusieurs visionnages n'ont jusqu'à présent pas entamée.
[4/4]